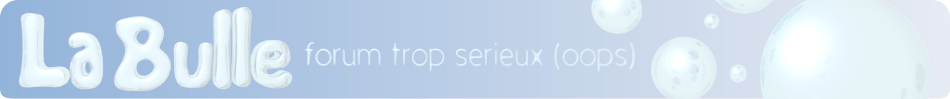| Auteur | Message |
|---|---|
|
Administrateur
|
Les champignons absorbent 36 % des émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. Ça fait une autre raison de ne pas focaliser exclusivement sur les arbres, de ne pas réduire l’environnement en focalisant sur le CO2 anthropique ; même si les champignons sont souvent liés aux arbres, ils sont aussi liés aux herbacées des prairies ou pas et parfois ils peuvent être simplement là comme ça.
Inédit ! La première cartographie du réseau mondial de champignons révèle une biodiversité méconnue — Le Blob — 25 Juillet 2025 Ce reportage est malheureusement trop court, mais il est bien quand‑même et les gens qui l’ont fait, l’ont fait. |
|
Administrateur
|
Il a été plusieurs fois mentionné, que même si les arbres sont biens, qu’ils ont le droit d’être là, planter des arbres partout pour résoudre les changements climatiques, n’est pas une bonne idée. Parce que ça dénaturerait l’environnement qui a toujours eu besoin de prairies, que ça serait un façonnage par intérêt, plus que destructeurs que favorables aux diverses formes de vie (une forêt, c’est réducteur, surtout une forêt de l’hémisphère nord), donc une continuation des mêmes erreurs avec de nouvelles conséquences, en plus que les arbres n’absorbent pas autant de CO2 que souvent annoncé (quand ils sont petits, ils en rejettent même plus qu’ils n’en absorbent).
Voici justement une vidéo qui en parle globalement, même si en ne présentant pas assez les détails. “Are we the idiots?”: Bill Gates on planting trees — Sabine Hossenfelder — 6 Juin 2024 |
|
Administrateur
|
Les méga‑bassine ont parfois une alternative possible.
En Espagne, à l’origine en Andalousie, importée par les Arabes il y a plusieurs siècles, alors peut‑être aussi dans une partie de l’Afrique et du Moyen‑orient, il existe une technique d’accumulation des eaux de pluies hivernales, sans réservoir. La technique, qui ne pratique dans les régions au moins un peu montagneuse, consiste à détourner une partie du cours et rivières et ruisseau, en hiver, et l’eau détournée via des tout petits canaux peu larges et peu profonds, appelés des acéquias, vers des zones où il n’y a pas spontanément d’écoulement d’eau. L’eau s’infiltre dans le sol en redescendant très lentement vers les vallées où elle fini par arrivée des mois plus tard en petit ruisseaux, souvent dans le courant de l’été, quand il n’y a presque plus rien dans les autres cours d’eau. Le détournement de cette eau est contrôlée par des grosses pierres qui empêchent l’eau de passer à moins qu’elles ne soient retirées. C’est ce qui est fait tous les ans en hiver, en même temps que de nettoyer le fonds de ces petits canaux, qui finissent par s’encombrer de feuilles d’arbres ou autres. Mais ça suggère des conditions. D’abord un dénivelé assez important entre les endroits où de l’eau peut être détournée une partie de l’année et les lieux où on espère la récupérer des mois plus tard. Il faut que l’eau finisse effectivement par arriver dans les vallées plutôt que de filer vers le profondeurs de la Terre et ne jamais être récupérable ou des seulement des milliers d’années plus tard. Il faut aussi que cette écoulement soit pourtant aussi assez lent, pour ne pas que l’eau resurgisse trop tôt en surface, et à une profondeur minimum pour éviter la perte par évaporation. Ça inviterait à faire des études géologiques préalables. Il faut aussi probablement que la consommation d’eau soit raisonnable, alors même si ça convenait aux anciens Paysans Andalous, il n’est pas certains que ça conviendrait aux très grandes exploitations d’agriculture intensive, qui sont le plus souvent situées dans les grandes plaines. Un autre avantage de ce système, est qu’il peut irriguer des zones qui sont habituellement privées d’eau, comme des prairies ou des forêts, si l’eau n’est pas trop profonde pour être accessibles à leurs racines. En montagne, il y a de bonnes raisons d’espérer que l’eau récupérée soit potable et enrichie en quelques minéraux, mais mieux vaut toujours s’assurer de la potabilité, surtout avec les sols de plus en plus souvent polluées. Cette technique a été récemment remémorée dans quelques régions d’Espagne où des anciennes acéquias qui avaient subsisté, ont été réparées et réutilisées. |
|
Administrateur
|
Ça n’est pas en rapport avec le réchauffement climatique mais plus avec la place laissée à la Nature par les Humains, ce qui est une question plus générale et plus importante encore que le seul changement climatique et une question aussi qui peut difficilement faire débat.
Il existe encore quelques rares saumons sauvages en france (et peut‑être en Europe), mais ils sont menacés par les obstacles infranchissables que sont les barrages hydroélectriques, nmbreux en france. Ces obstacles sont peut‑être encore plus infranchissables que ne le sont les autoroutes. Une solution pertinente a été trouvée pour au moins un site, celui de Poutès, en Haute‑Loire, dans le Massif Central. L’idée est simplement d’arrêter la production électrique pendant deux mois de l’année, pour que les saumons qui remontent toujours le cours des fleuves jusqu’au lieu où iels sont né‑es (il me semble qu’ils le reconnaissent aux parfums des eaux qu’ils ont connu). Ça signifie se priver de production d’électricité pendant deux mois de l’année, donc consommer moins d’électricité en tout (parce que pendant ce temps, il faut se reporter sur d’autres producteurs qui subviennent habituellement à une autre demande), mais il ne faut pas oublier que ça signifie que le cours du fleuve reste quand‑même monopolisé par les humains pendant dix mois de l’année, ce qui n’est pas du tout un compromis abusif pour les humains. C’est pertinent, parce que ça ne repose pas que sur la promesse d’un miracle ou « miracle » technique à venir, mais sur l’acceptation du partage de l’environnement, ce qui est la seule solution vraiment pérenne. L’initiative est rapportée par une certaine Aurore Baisez, observatrice et préservatrice des trésors naturels aquatiques, dans une vidéo de ARTE qui n’est pas postée, parce que comme toutes les vidéos d’ARTE, sa disparition est prévue à échéance et même une courte échéance de seulement deux mois dans le cas de ce reportage. Le titre est « Redonner vie aux rivières », dans la série « Les promesses de la Terre », dans le cadre de ARTE Family. |
|
Administrateur
|
Pas en rapport avec le réchauffement climatique, mais en rapport avec une forme de sobriété, appelée la sobriété foncière.
Dans le documentaire ci‑dessous, quelqu’un dit une chose intéressante : il est difficile de faire protéger une terre si elle n’abrite pas des espèces protégées ou si elle n’a pas quelque chose de particulier qui la distingue des autres. Il défend que même les terres ordinaires ont un intérêt pour l’écologie. Pour cela, il défend la sobriété foncière, c’est à dire la fin de la bétonisation, déjà pratiquée par quelques communes. C’est en effet la bétonisation qui est la principale menace actuelle pour les formes de vie dans la nature, pas seulement les monocultures ou les pesticides. Les dangers de la bétonisation des sols — France 3 Centre‑Val de Loire — 1 Octobre 2025 |
|
Administrateur
|
Alors que la génération de CO2 devrait baisser de 5 % par an pour limiter le réchauffement maximum à 2 ℃, la consommation énergétique du numérique, augmente de 9 % par an. Certes, c’est de l’électricité, mais elle n’est pas toujours décarbonée et cette consommation électrique va en concurrence à l’encontre de la consommation électrique pour le transport, dont les voitures électriques.
Jancovici note que les IA ne sont pas les seuls responsables, que le bilan concerne tous les centres de données en général. En plus des IAs, il y aussi le cloud, où les entreprises archivent « tout et n’importe quoi ». Concernant les IAs, il ne pense pas qu‘il faille les abolir (d’un point de vue technique, il n’aborde pas la question éthique), il propose d’utiliser plutôt des IAs moins généralistes, plus spécialisées dans leurs domaines particuliers. Les IAs généralistes, sont celles qui consomment le plus et ça inclus les IAs qui créent des images ou des animations, d’après un simple texte descriptif (appelé un prompt). Avant les IAs, il existait des logiciels appelés «systèmes experts », qui ne pouvaient que consommer moins, puisqu’ils existaient déjà dans les années 1980/90. Consommation de l’IA : « les chiffres ne sont pas très sympathiques à regarder » — RTL — 4 Octobre 2025 |