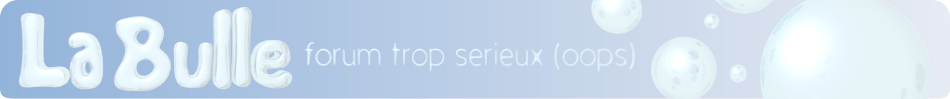| Auteur | Message |
|---|---|
|
Administrateur
|
Hibou a écrit : La toxine botulique produite avec certaines mauvaises conservations, inodore et sans goût, ce qui la rend traitre, peut être détruite par la cuisson : à une température minimale de 80 à 90 ℃, par exemple 5 minutes 85 ℃ détruit la toxine. Non, ce temps que j’avais indiqué est trop court, c’était une erreur. Est nécessaire, une cuisson d’au minimum 10 minutes à 100 ℃ ou 30 minutes à 85 ℃. La toxine botulique est d’ailleurs plus facile à détruire que la bactérie qui la produit, qui est encore bien plus facile à détruire que le spore dont elle est issue. La bactérie est très rarement une cause d’infection, c’est la toxine qui l’est, rarement, mais généralement gravement. Il n’existe pas une, mais des toxines botuliques. La bactérie produisant le toxine botulique, se trouve naturellement dans la terre, c’est une bactérie tellurique. Voir ce document d’une université de médecine : Les bacilles à gram positif sporules (jussieu.fr). |
|
Administrateur
|
Des cèdres de l’Atlas poussent dans l’est de la france. Mais j’ignore si leurs graines sont comestibles et intéressantes.
|
|
Administrateur
|
Pas à propos d’une plante comestible, mais pour noter que hier j’ai remarqué que les jonquilles qui commencent à pousser depuis plusieurs jours, commencent pour certaines à former leurs bouton floraux. C’est un peu précoce, je dirais avec trois semaines d’avance environ.
|
|
Administrateur
|
Hibou a écrit : […] Pour le pissenlit, ça dépend des lieux de récolte. J’en ai refais plusieurs autres depuis, et j’arrivais à 60 % du poids brut récolté, il n’y avait presque pas de feuilles en mauvais état, le 40 % non‑gardé n’était quasiment que le bout de racine. Avec la bourse à pasteur, il serait difficile de faire mieux que 40 ou 45 %, comme les feuilles sont proportionnellement plus petites. |
|
Administrateur
|
Cuit, le pissenlit n’est pas du tout amer comme le reste la chicorée, il ne l’est plus du tout. Pendant la cuisson il dégage un arôme épais proche de ce qui est obtenu avec le laiteron, et après cuisson, c’est fondant comme avec le laiteron, encore.
Pour les gens qui ne connaissent pas le laiteron, il est possible d’imaginer la comparaison avec la feuille de bette à la place. |
|
Administrateur
|
En Afrique, la mauve est récoltée la feuille entière, avec le pétiole (qui est le plus souvent long).
Je ne récoltais toujours que le limbe en laissant le pétiole sur le pied. Il faudra tester la feuille entière, mais en cuisinant et saumurant le limbe et le pétiole séparément, pour comparer leurs goûts et leurs textures. |
|
Administrateur
|
La vesce (ou plutôt, les vesces) contient des facteurs anti‑nutritionnels qui la rend impropre à la consommation par les mono‑gastriques, dont font partie les humains.
|
|
Administrateur
|
Il y a quelques jours, j’ai remarqué des jonquilles en fleurs.
La cardamine hirsute est en fleurs un peu partout où il y en a. La stellaire semble bien se porter. |
|
Administrateur
|
La crépide fausse lampsane, comme son nom l’indique, pourrait être prise à tord pour de la lampsane. Cette crépide a des feuilles embrassantes, à la manière de celle du laiteron maraîcher ou du laiteron rude. La lampsane a des oreilles à la base des feuilles, mais petites et pas du tout embrassantes. Ce point devrait suffire à les distinguer.
J’ignore si la crépide fausse lampsane est toxique ou pas. Elle semble être une liguliflore, alors je dirais que statistiquement, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas toxique, mais mieux vaut savoir les différencier. |
|
Administrateur
|
Il existe en Europe, au moins 9 espèces de stellaire, si on entend par là les caryophyllacées du genre stellaria. Généralement a feuilles allongées, la stellaire intermédiaire, n’étant pas une typique représentante des autres.
Il existe une stellaire particulier, qui ressemble beaucoup à la stellaire intermédiaire, c’est la stellaire pâle, dont les fleurs ne s’ouvrent quasiment jamais et qui quand elles s’ouvrent, n’ouvrent que quelques pétales translucides à peine visibles. |