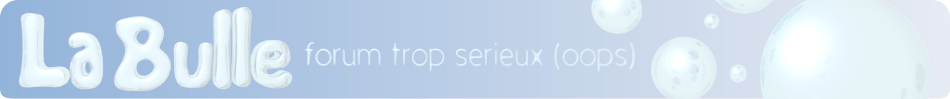| Auteur | Message |
|---|---|
|
Administrateur
|
La capacité des plantes à produire de la matière organique à partir de matière inorganique et de minéraux, est nommé l’autotrophie (une capacité qui n’est pas réservée au règne des plantes). Les plantes sont dites autotrophes.
|
|
Administrateur
|
Les champignons digèrent, ils produisent des enzymes pour ça. Ça montre que les champignons ne sont pas des plantes.
Certains champignons peuvent même digérer la roche. Il y a quand‑même un lien entre les champignons et les plantes : ce sont les champignons qui ont permis aux plantes de s’installer sur Terre. Parmi ces premiers champignons qui ont créé le substrat propice aux plantes, certains, les prototaxites, mesuraient plus de 8 m de haut. Ils ont disparu depuis, peut‑être parce qu’ils étaient dévorés par les insectes. Les champignons actuels les plus proches, seraient les champignons du genre polypore, qui maintenant se développent sur les arbres au lieu de sur la roche. Ces premiers champignons ont permis la naissance des premières forêts, qui étaient des forêts de conifères. Un lien subsiste encore entre les plantes (ce qui inclut les arbres) et les champignons, via la mycorhize, ou entre les champignons et les protistes capables de photosynthèse — comme les algues — une symbiose donnant les lichens. Après chacune des extinctions de masse, ce sont encore les champignons qui se sont réinstallés partout. |
|
Administrateur
|
Treubia lacunosa, une plante contemporaine, est très proches des premières plantes d’il y a 400 millions d’années.
|
|
Administrateur
|
Les racines des arbres contiennent souvent un composé pourpre sur une bonne épaisseur à partir de l’extérieur juste sous « l’écorce » ; je me demande ce que c’est.
|
|
Administrateur
|
Chez les arbres, la partie aérienne et la partie souterraine, ne sont pas faites du même bois, celui de la partie souterraine est nettement plus fragile que celui de la partie aérienne.
|
|
Administrateur
|
La spiruline n’est pas une algue, c’est une cyanobactérie.
|
|
Administrateur
|
Dans un passé pas si lointain, les cyanobactéries étaient trompeusement appelées « algues bleues ». C’est peut‑être ce qui a fait dire à des gens que la spiruline est une algue, alors que c’est une bactérie.
Cependant, il y a bien un lien entre les cyanobactéries et les algues ou les plantes, les algues étant des plantes : la lignée verte, celle des plantes, a pour origine une endosymbiose entre des eucaryotes et des cyanobactéries (et une bactérie parasite ayant rendu la symbiose utile en pratique). Cette symbiose est à l’origine des algues, les vraies, puis plus tardivement à l’origine des plantes terrestres. Cet ancêtre commun aux algues et aux plantes terrestres, est apparu il y a un milliard et six‑cent millions d’années, ce qui est beaucoup plus ancien que les plantes terrestres apparues plus tard (il y a de 300 à 500 millions d’années, de mémoire — voir date plus précise précédemment dans ce sujet). |
|
Administrateur
|
Les plantes n’ont pas toujours fait des graines. Les premières graines sont apparues au Dévonien ; c’est à dire il y entre 360 et 410 millions d’années, apparemment plutôt il y a 385 millions d’années au plus tôt, date de l’apparition des proto‑ovules chez les plantes. Les plantes à graine sont devenues courantes au Carbonifère, c’est à dire il y a entre 360 et 300 millions d’années. Les proto‑pollen sont apparus il y a 365 millions d’années.
La source est un document qui sera indiqué plus tard. Les plantes n’ont pas toujours eu des feuilles non‑plus, mais je ne sais pas quand les premières feuilles sont apparues. |
|
Administrateur
|
En plus de l’autogamie et de l’allogamie, il existe l’agamospermie avec laquelle il n’y a même pas besoin de pollinisation du tout pour faire une graine. L’agamospermie se trouve surtout chez des astéracées, des rosacées et des poacées, mais les espèces de ces familles ne sont pas toutes agamospermes.
|
|
Administrateur
|
Hibou a écrit : […] C’est très technique, mais ça peut être survolé avec intérêt : La reproduction chez les végétaux (serres.u-bourgogne.fr) [PDF]. Voir en particulier les pages expliquant les différents moyens par lesquels les plantes allogames évitent l’ autofécondation. Voir aussi, pour l’image en haut de page : Les modes de fécondation chez les végétaux (ecosociosystemes.fr). |