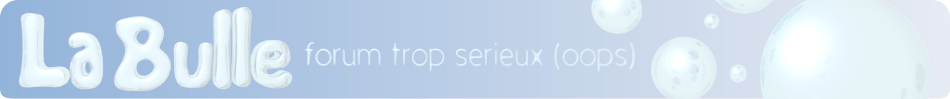| Auteur | Message |
|---|---|
|
Administrateur
|
Un certain Gérard Ducerf qui pourrait faire penser à François Couplan, a publié trois livres sur les plantes sauvages comestibles, qui complètent ceux de Couplan. C’est en trois volumes. Faites attention au rééditions qui peuvent parfois contenir des corrections par rapport aux anciennes, et ça s’applique d’ailleurs aussi aux livres de Couplan.
Le hic des livres de Ducerf, c’est qu’ils sont plus chers que ceux de Couplan (60 € vs 30 à 40 €), mais ils portent aussi sur les plantes bio‑indicatrices, ce qui peut en faire un investissement intéressant pour l’agricultures même sur les petites surfaces. Et puis il n’est peut‑être pas nécessaire d’avoir tous les volumes. Je me demande justement comment choisir un volume plutôt qu’un autre. Les trois volumes : |
|
Administrateur
|
Il se dit que si on consomme trop, les noix peuvent provoquer des aphtes et des caries. Je ne sais pas selon quel processus, c’est à vérifier.
|
|
Administrateur
|
Il ne semble pas y avoir de différence entre la ciboulette sauvage et la ciboulette cultivée, les deux semblent être l’allium schoenoprasum L.
Pourtant la ciboulette que j’avais mis il y a quatre ans dans une jardinière et qui repousse toute seule tout les ans, repousse en ce moment, et la ciboulette que j’avais vu dans un coin de bois au début de l’année, semble avoir disparue. |
|
Administrateur
|
Je viens d’identifier une crucifère que j’avais vu fleurir au printemps sur le bord d’un cours d’eau et que je n’avais pas réussi à identifier à ce moment là. C’est un cranson, aussi connu sous le nom de raifort, et le raifort, tout le monde connait de nom. Alors le raifort est spontané dans certaines régions …
C’est une brassicacée (ex‑crucifère) qui monte assez haut (1 m à 1 m50 environ), à fleurs blanches dont les quatre pétales ont tendance à se regrouper en deux groupes de deux, avec des feuilles allongées à denture discrète et arrondie orientée vers la pointe, entre vert franc et vert sombre, de texture lisse, plus grandes à mesure qu’on va vers le pied ; au froissement la plante a nettement une odeur de brassicacée. Les feuilles basale sont tellement grandes qu’elles peuvent faire penser à du rumex crépu. On peut reconnaitre le raifort à la denture ronde et à la large ondulation de ses feuilles, tandis que celles du rumex crépu ont une ondulation plus anarchique quand elles en ont une et n’ont pas la denture ronde de celles du raifort. |
|
Administrateur
|
La sous‑espèce d’une plante peut avoir des caractéristiques assez différentes à certains égards.
Par exemple, la bette, Beta vulgaris L., est annuelle ou bisannuelle, tandis que la sous‑espèce Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang. est bisannuelle ou vivace. Le type végétatif étant différent, je me demande même pourquoi la deuxième est considérée comme une sous‑espèce de la première  . .
|
|
Administrateur
|
La feuille de raifort, c’est de surprise en surprise.
D’apparence, elle a l’air charnue, mais elle se flétrie assez facilement, ce qui laisse penser qu’elle sécherait mal. Au hachage, elle dégage une odeur comparable à celle de la moutarde noire ou blanche, mais moins forte, à moins que je ne me souvienne plus bien de cette odeur. Au moment de mettre dans l’eau bouillante au dessus du riz, elle prend une odeur plus délicate que la moutarde, ce qui m’a fait penser à la feuille de colza. Plus tard pendant la cuisson, j’ai cru que revenait une similitude avec la feuille de moutarde, puis soudainement, ça me revient, c’est plutôt l’odeur de la racine d’alliaire. Au goût, je m’attendais à retrouver le colza, ce qui m’aurait arrangé comme le raifort est vivace, mais c’est finalement une amertume qui m’a fait penser à celle de la barbarée, peut‑être juste en moins marquée, ce qui pourrait aussi faire penser à la feuille d’alliaire, qui elle aussi devient amère à la cuisson. En résumé, si non‑cuite, à l’odeur elle tient à la fois de la moutarde et du colza, cuite, au goût elle tient à la fois de la barbarée et de l’alliaire, et pendant la cuisson, elle ressemble au colza et à la racine d’alliaire. Ses fleurs sont blanches, comme celle de l’alliaire. Je referai un test en la faisant blanchir à l’eau bouillante pendant une ou deux minutes, pour voir si c’est assez court pour que l’amertume ne se développe pas et voir quel goût elle a alors. Pour l’instant, je la vois bien en fourrage de pain, comme le colza et la moutarde. Pas en tourte, parce qu’elle est trop amère pour ça et que dans une tourte la proportion de fourrage est plus importante. Comme pour la barbarée, son amertume se marie bien avec le gout acide du vinaigre de cidre. |
|
Administrateur
|
Hibou a écrit : […] Les feuilles basales du raifort peuvent avoir plus que des dents arrondies, elles peuvent avoir une série d’échancrures arrondies sur quelques feuilles (ou aucune), surtout vers la pointe, mais parfois aussi en plus de vers la pointe, sur une bonne partie du reste de la longueur dans la direction de la base. |
|
Administrateur
|
Une liste de plantes comestibles, sur trois pages, je ne donne que la première : Guide des plantes comestibles (hermeline-plantes-sauvages.com). Comme source d’inspiration seulement, ne pas utiliser sans vérifications préalables, par exemple, la toxicité de la rue (la plante) et de la vipérine ne sont pas mentionnées !
Et sur un autre site, une liste de plantes toxiques, sur trois pages aussi, et là encore, je ne donne que la première : Flore toxique (uiabotanique.free.fr). |
|
Administrateur
|
Attention : il est possible que le plantain d’eau soit toxique, il l’est au moins pour plusieurs animaux domestiques. Le plantain d’eau est un plantain à grosses feuilles souples. Je crois que c’est celui qu’on voit sur les bords des cours d’eau.
|
|
Administrateur
|
Le panais sauvage, n’est pas le panais, le panais sauvage est le nom que certaines personnes donnent à l’angélique sylvestre. Le panais tout‑court, c’est le panais cultivé, même s’il est spontané est donc sauvage.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » 
|